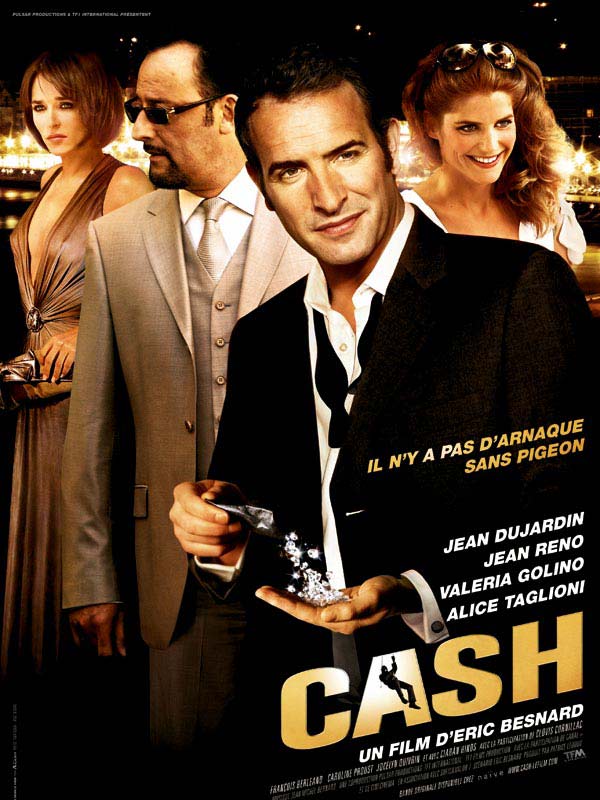Tirer sur les ambulances n'est vraiment pas une chose louable. Conspué par le grand public depuis sa sortie,
Da Vinci Code est un effet un très (mais alors très, très, très) mauvais film.
Adapté du
successful roman de Dan Brown (pas lu) (d'ailleurs, c'est drôle, quand on demande aux gens, personne ne l'a lu, à se demander s'il n'y a pas un type qui a acheté tous les exemplaires pour préserver l'humanité),
Da Vinci Code était attendu comme le Messie par tous les fanas du bouquin (mais si, mais si, il y en a sans doute qui avouent l'avoir lu et aimé). Et le résultat est loin d'être anecdotique. Car la nullité de
Da Vinci Code dépasse l'entendement humain. Presque trop facile à critiquer.
Il y a d'abord la "réalisation" de Ron Howard, honnête tacheron des années 90 qui décida un jour de devenir un cinéaste respectable (et qui n'aurait évidemment pas dû). On a rarement vu un tel hachis parmentier d'images incohérentes, pas montées, granuleuses pour faire du mystère, pas éclairées pour faire dans le français (dans tous les mauvais films américains se déroulant en France, il fait nuit quelle que soit l'heure de la journée). Soulignant comme d'habitude chaque élément au Stabilo (desfois qu'on n'ait pas bien compris), Howard signe sa pire réalisation, ce qui n'est pas peu dire. Son chef op, un certain Salvatore Totino, peut s'estimer heureux d'avoir trouvé du travail sur une production de cette envergure : c'est sans doute la dernière fois.
Il y a ensuite l'adaptation d'Akiva Goldsman. Alors de deux choses l'une : soit le roman de Brown est un incommensurable ramassis de n'importe quoi, une compilation d'énigmes éculées et de stéréotypes sur pattes, soit Goldsman, misérable écrivaillon aux antécédents édifiants, s'est encore surpassé. On ne croit à rien plus d'une seconde, les révélations surprenantes font rire des salles entières, et même les acteurs semblent se demander ce qu'ils font là. C'est le problème avec ce genre de bouquin abracadabrantesque, avec des retournements de situation tous les quarts d'heure et une bonne grosse thèse poisseuse pour faire intelligent : si ça peut éventuellement passer dans un gros pavé de 700 pages, à l'écran on ne voit que le ridicule et la surenchère débile des situations. Rappelons-nous sans rire des adaptations des romanes de Jean-Christophe Grangé. Sans rire, j'ai dit.
Alors forcément, face à un tel ramassis de n'importe quoi, on n'a même pas envie de blâmer les acteurs, pour qui ça n'a pas dû être rigolo tous les jours. Audrey Tautou est parfaitement concentrée sur son anglais, ça lui évite d'avoir à jouer. Tom Hanks s'est laissé pousser les cheveux, c'est sa caution Actor's Studio. Jean Reno est plus drôle que dans
La panthère rose. Paul Bettany est très marrant aussi. Heureusement, Monsieur Ian McKellen est là, et nous offre les seuls moments à peu près potables du film (soit environ huit minutes sur cent-cinquante). Le 1/10, c'est pour lui. Et comme on se divertit comme on peut, on se délectera des prestations éclatantes de la fine fleur des comédiens français, de David Saracino à Etienne Chicot, avec une mention spéciale à Denis Podalydès et son sandwich (on ne fait pas un film sur la France sans un petit coup de "les Français sont des feignants").
La thèse (anti-)religieuse du film, elle, n'inspire même pas les quolibets. On est trop occupé à rire pour cela. Et même si elle est mal amenée et archi-téléphonée, il n'est pas interdit d'y trouver un fond d'intérêt. Ce serait quand même fendard que Jésus ait couché, non? Il y a bien des prêtres abstinents qui s'en mordraient les doigts...
On ne tire pas sur une ambulance. Mais quand elle coûte 125 millions de dollars, c'est quand même un devoir que de dénoncer le gigantesque puits de rien qu'est ce
Da Vinci Code.
1/10
 Aux États-Unis, ils ont James Gray et Michael Mann. En France, on a Gilles Paquet-Brenner et Laurent Tuel. La vie est tellement injuste. Comme son collègue de Gomez & Tavarès, le touche-à-tout Tuel lorgne ici du côté de la tension moite de Heat et Miami Vice et du drame familial façon The yards. Et si ces modèles auraient été écrasants pour n'importe quel réalisateur français, ils réduisent carrément ce Premier cercle en bouillie.
Aux États-Unis, ils ont James Gray et Michael Mann. En France, on a Gilles Paquet-Brenner et Laurent Tuel. La vie est tellement injuste. Comme son collègue de Gomez & Tavarès, le touche-à-tout Tuel lorgne ici du côté de la tension moite de Heat et Miami Vice et du drame familial façon The yards. Et si ces modèles auraient été écrasants pour n'importe quel réalisateur français, ils réduisent carrément ce Premier cercle en bouillie.